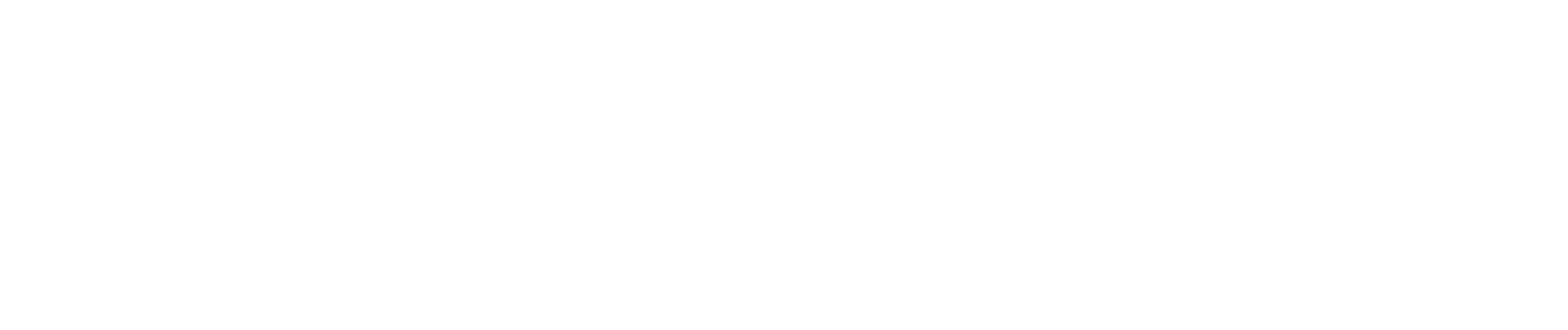Roman foisonnant, délibérément anachronique, La Reine et le Soldat, de Felicia Mihali, nous plonge en plein coeur des conquêtes d’Alexandre le Grand, en 330 avant Jésus-Christ. La reine des Perses, Sisyggambris (nom réel: Sisygambis), assiste impuissante à l’écroulement de son royaume. Captive dans la ville de Suse (sur le territoire actuel de l’Iran), elle est placée sous la garde d’un jeune soldat grec, trois fois plus jeune qu’elle.
Avec une écriture vigoureuse, l’auteure trace le portrait d’une femme indépendante et libre, amante passionnée, femme d’esprit, et tisse en filigrane dans son récit des réflexions sur l’exil, le métissage, l’art de la guerre et la démocratie.
Alphabet érotique
L’empire en déclin des Perses n’a pas résisté à l’assaut des armées du redoutable conquérant. Installé à Suse, Alexandre le Grand se montre magnanime envers Sisyggambris, après la mort de Darius, le roi des Perses, tué au combat. Une étrange amitié se noue entre la reine et le Macédonien. Elle apprend à connaître cet homme dont les actes prouvent sa nature humaine passionnée, il découvre le raffinement perse — mobilier précieux, appartements parfumés, bain raffiné, banquets somptueux. La reine le nomme Iskenderun après en avoir fait son fils adoptif. Alexandre le Grand poursuivra sa politique d’alliance avec la noblesse perse — les soldats macédoniens prennent concubines en pays conquis –, voyant dans ce rituel d’union des peuples «le bonheur du monde en termes de mélange, d’hybridité et de métissage».
Après la conquête du royaume persan, désireux d’étendre son empire de la Grèce à l’Indus, Alexandre reprend la route. Il confie la reine à Polystratus, jeune soldat d’à peine vingt ans, à qui elle enseignera l’ouverture à l’autre. À ses yeux, tous les Grecs sont des barbares.
Au fil des mois, Sisyggambris attend des nouvelles d’Alexandre qui ne viennent pas. L’arrivée d’une troupe de comédiens chinois vient la distraire. Le plus vieil acteur a été l’un de ses amants. À partir de cette rencontre, le récit se teinte d’une frénésie érotique. «La reine savait depuis longtemps que les jeux érotiques font partie du métier de gouverner les autres.»
Après le départ de la troupe, la reine intrigue, cherche des issues à son ennui, jusqu’au jour où elle convainc le soldat de partir en Grèce à la recherche d’Iskenderun. En cours de route, ils deviennent amants. Ils se perdent pour mieux se retrouver, leurs désirs se fondent «dans le crépitement du monde». Le plaisir fermente jusque dans les mots.
Exil et nostalgie
Après un périple difficile, ils arrivent à Athènes. Pour Sisyggambris, l’exil se vit d’abord au plus près de la peau. La reine et le soldat déclinent ensemble «les lettres du même alphabet érotique». Pour combien de temps encore ? Son amour pour le soldat d’Alexandre avait été lié à sa position de conquérant. À Athènes, ses yeux «trahissent le sommeil profond de l’esprit».
La reine se penche sur son passé, n’arrive plus à y mettre de l’ordre. Elle souffre chaque jour de sa condition d’étrangère. «Elle allait toujours parler le grec avec un accent perse […] Au fond, les gens ne peuvent jamais fuir ce qu’ils sont en profondeur.» Une rencontre avec un marchand de parfums syrien qu’elle a connu à Suse ravive la nostalgie de leur Perse natale : «Il comprenait avec tristesse que le soleil ne pourrait jamais être si familier que dans le pays où l’on naît, et qu’une certaine fraîcheur de la matinée resterait toujours identique à celle de l’enfance.»
Sisyggambris s’adapte lentement à sa nouvelle vie. Ce voyage a été pour elle un chemin obscur vers les profondeurs de son âme. Qui sait si le soleil du Péloponnèse aura le pouvoir de l’illuminer, de le rendre plus chaleureux ?
Roman dense, exigeant
À la fin du roman, dans une note à l’intention du lecteur, Felicia Mihali précise qu’elle a pris beaucoup de libertés par rapport aux faits historiques. Elle recompose l’Histoire par fragments en s’écartant de l’original, établit des liens troublants entre les idéaux éthiques d’Alexandre le Grand, la démocratie qu’il défendait, «pas égalitaire mais militaire et agressive», et les motivations des Américains qui occupent aujourd’hui Bagdad. «Les populations du milieu du continent ne l’accueillaient pas comme un libérateur, mais plutôt comme un oppresseur antipathique. L’idéal démocratique, qu’il brandissait comme un drapeau et dont il se considérait comme le champion, n’était pas la préoccupation des peuples du Caucase, de Sogdiane ou de Kaboul. Ces peuples de l’Indus s’accommodaient fort bien de la paix imposée par les suzerains locaux, avec qui ils parlaient la même langue et partageaient les mêmes coutumes […] Ceux qui s’avancent trop sur le territoire des autres ne sont en aucun cas des libérateurs.»
Née en Roumanie, écrivaine, journaliste, rédactrice en chef du magazine culturel en ligne Terra Nova, Felicia Mihali signe un troisième roman dense, exigeant, pétillant d’intelligence. Douée d’une imagination inépuisable, la romancière parvient à ressusciter le passé lointain d’une civilisation qui a dominé le Proche-Orient il y a plus de 2500 ans, à en restituer les couleurs, les odeurs, les sensations tactiles et à nous transmettre la beauté d’une histoire d’amour impossible qui ne peut se trouver consignée que dans une oeuvre de fiction.
Suzanne Giguère – Le Devoir, Édition du samedi 21 et du dimanche 22 janvier 2006